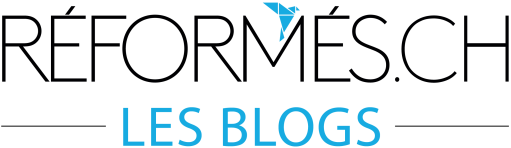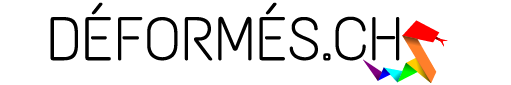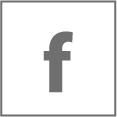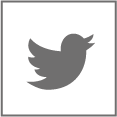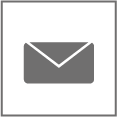L’idée d’un îlot où les choses vont bien, n’existe plus
L’Inde de Narendra Modi fait partie des rares pays qui se sont réjouis de la fermeture de l’agence américaine d’aide au développement. Mais en coulisses, nombre de commentateurs pointent ouvertement les hypocrisies et faiblesses de l’aide au développement, loin d’être une activité humaniste. «Toute l’entreprise de l’aide a été un outil de contrôle géopolitique, un moyen de préserver plutôt que d’éliminer l’inégalité mondiale et l’extraction des ressources qui l’alimente», estime Patrick Gathara, rédacteur en chef de The New Humanitarian, dans une note de blog sur Aljzeera.com.
Les politiques de développement sont-elles à ce point instrumentalisées? «Toute aide au développement est politique. Aucun Etat n’aide gratuitement», reprend Davide Rodogno, professeur d’histoire internationale et de politique à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève (IHEID). Cette dimension politique est, en soi, compréhensible. L’aide au développement procure aux pays qui la donnent des contrats, une présence dans une zone géographique, une influence, tout ce qui constitue le fameux soft power…
L’un des malentendus reste que cette logique «n’est jamais vraiment dite», thématisée, discutée, remarque Davide Rodogno. L’autre problème est que ces relations se sont souvent établies «d’un Etat colonisateur vers une ancienne colonie, par exemple du Portugal vers le Mozambique, mais cela vaut aussi pour la France, la Grande-Bretagne» D’ailleurs, «c’est historiquement prouvé, les postes des premiers experts du développement dans les agences onusiennes ou étatiques chargées de ce travail… ont tout simplement été occupés par d’anciens administrateurs coloniaux», explique le professeur.
Défis existentiels
Au fil des ans, des réflexes impérialistes ont perduré et ce système international de développement «ne s’est jamais adapté aux changements des équilibres géopolitiques survenus après 1945. Il n’a pas été capable de faire face aux défis existentiels comme le changement climatique ni réussi à faire preuve d’efficacité et a toujours pratiqué de doubles standards», a constaté Heba Aly, coordinatrice de la coalition pour la réforme de la charte des Nations unies, dans une conférence donnée à l’IHEID.
Les critiques sont anciennes. Enfin, pour Davide Rodogno, la question de la durabilité, en particulier, a été très mal vécue par les pays du Sud: «Ils ont dit légitimement: ‹Au moment où nous pourrions nous développer, pourquoi devrions-nous nous plier à des contraintes environnementales alors que ce sont vos entreprises – d’extraction minière, par exemple – qui ont détruit nos écosystèmes?›»
Nombreuses incertitudes
Si la mue de l’aide au développement est en cours, la configuration qui se dessine aujourd’hui reste très incertaine. Une chose est sûre, «il ne s’agira pas d’un modèle de développement unique», assure Davide Rodogno. Au sein d’une région, par secteurs, par pôles, de nouveaux partenariats émergent. En Afrique de l’Ouest, par exemple, les Russes du groupe Wagner remplacent la France pour assurer la sécurité. En Ethiopie, la Chine construit des usines. Et dans les pays du Nord, touchés par des inondations inédites, la fonte des glaciers ou des épidémies d’opiacés, de nouveaux besoins se font ressentir.
«C’est toute la notion de développement qui est interrogée. L’idée d’un îlot où les choses vont bien et qui pense le développement pour le reste du monde n’existe plus», explique Davide Rodogno. Quelles que soient les évolutions du concept et des termes – le mot «durabilité» a remplacé celui de «développement» –, l’évolution de la coopération internationale ne peut s’effectuer que dans un contexte, insistent les chercheurs: celui de la paix et du dialogue.