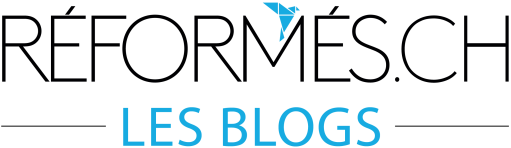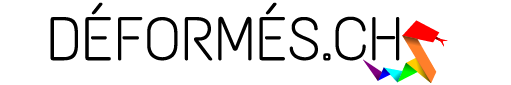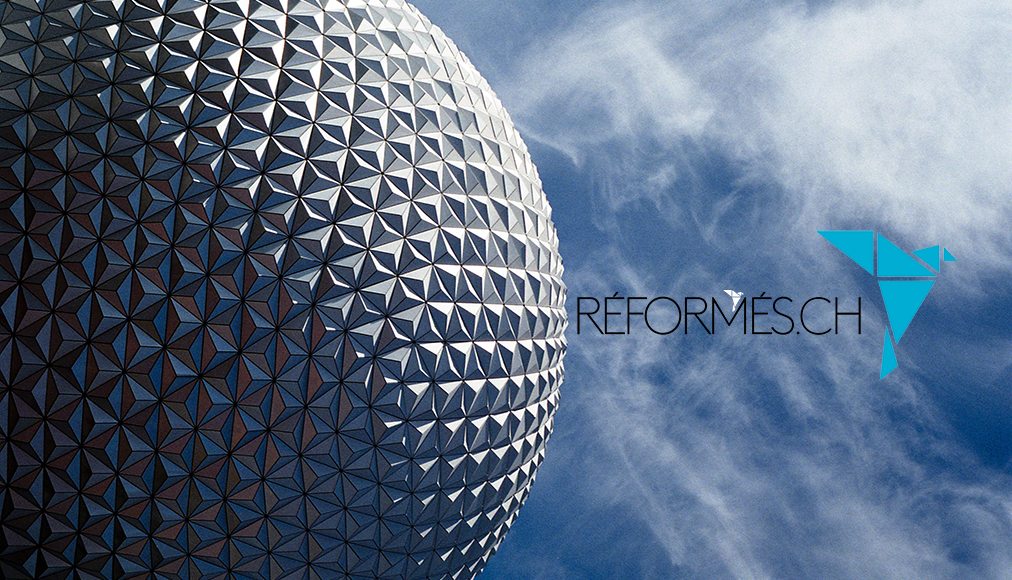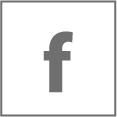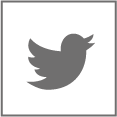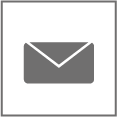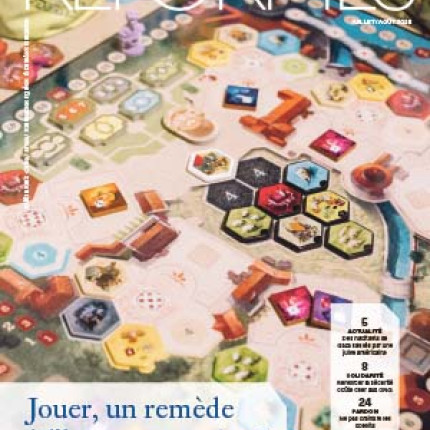L'enseignement religieux dans le monde
28 janvier 2005
Un récent article du "Monde des religions" propose un survol de place des religions dans les écoles du monde
Ce tour d’horizon a le mérite de rappeler que le modèle français, qui considère que l’éducation religieuse relève spécifiquement de la sphère privée, constitue l’exception sur notre continent. Ainsi, En Grande-Bretagne, l’école publique doit autant s’intéresser au développement « spirituel » des élèves qu’à leur épanouissement physique ou culturel. L’Allemagne a fait de l’instruction religieuse une discipline obligatoire, alors que la Belgique considère cet enseignement comme un droit, avec un programme préparé par les communautés tout comme en Pologne et en Italie. L’élève choisit ou non d’y participer, comme aux Pays-Bas et en Grèce.
Mais qui dit enseignement confessionnel n’empêche pas les cours d’évoluer vers un contenu plus spécifiquement éthique ou d’histoire des religions. Il s’agit désormais davantage de préparer le jeune à se forger sa propre vision du monde et ses propres préceptes moraux, plutôt que de nourrir ou d’éveiller en lui une foi chrétienne. L’Espagne et l’Irlande se dirigent également vers une pluriconfessionnalité, passant en revue l’ensemble des grandes traditions. Tel n’est pas le cas de plusieurs pays de l’Est, la Pologne, la Serbie et la Russie en tête, qui ont au contraire remis la confession dominante du pays au centre des manuels.
Sur d’autres continents, aux Etats-Unis, chaque professeur est tenu d’aborder la dimension religieuse dans ces cours, mais la Constitution interdit tout enseignement à teneur religieuse (comme au Japon, désireux de tourner la page de l’époque shintoïste). On sait que dans certains Etats, et dans la lignée de l’administration Bush, certaines associations tentent de remettre ce principe en question. Le Mexique ne ménage aucun horaire pour un tel type d’enseignement, même en marge de l’école. A l’inverse, les pays de la sphère arabo-persique comme l’Iran, l’Arabie saoudite, le Pakistan et, à un degré moindre, le Maroc et l’Egypte, imposent l’apprentissage des préceptes de l’islam dans les classes publiques. Fait intéressant, la Turquie a introduit en 1982 un enseignement confessionnel et certains estiment qu’il faut y voir l’embryon d’une réislamisation du pays.
Mais qui dit enseignement confessionnel n’empêche pas les cours d’évoluer vers un contenu plus spécifiquement éthique ou d’histoire des religions. Il s’agit désormais davantage de préparer le jeune à se forger sa propre vision du monde et ses propres préceptes moraux, plutôt que de nourrir ou d’éveiller en lui une foi chrétienne. L’Espagne et l’Irlande se dirigent également vers une pluriconfessionnalité, passant en revue l’ensemble des grandes traditions. Tel n’est pas le cas de plusieurs pays de l’Est, la Pologne, la Serbie et la Russie en tête, qui ont au contraire remis la confession dominante du pays au centre des manuels.
Sur d’autres continents, aux Etats-Unis, chaque professeur est tenu d’aborder la dimension religieuse dans ces cours, mais la Constitution interdit tout enseignement à teneur religieuse (comme au Japon, désireux de tourner la page de l’époque shintoïste). On sait que dans certains Etats, et dans la lignée de l’administration Bush, certaines associations tentent de remettre ce principe en question. Le Mexique ne ménage aucun horaire pour un tel type d’enseignement, même en marge de l’école. A l’inverse, les pays de la sphère arabo-persique comme l’Iran, l’Arabie saoudite, le Pakistan et, à un degré moindre, le Maroc et l’Egypte, imposent l’apprentissage des préceptes de l’islam dans les classes publiques. Fait intéressant, la Turquie a introduit en 1982 un enseignement confessionnel et certains estiment qu’il faut y voir l’embryon d’une réislamisation du pays.