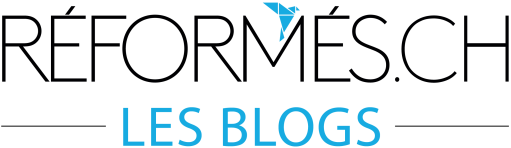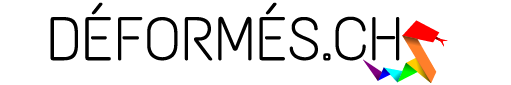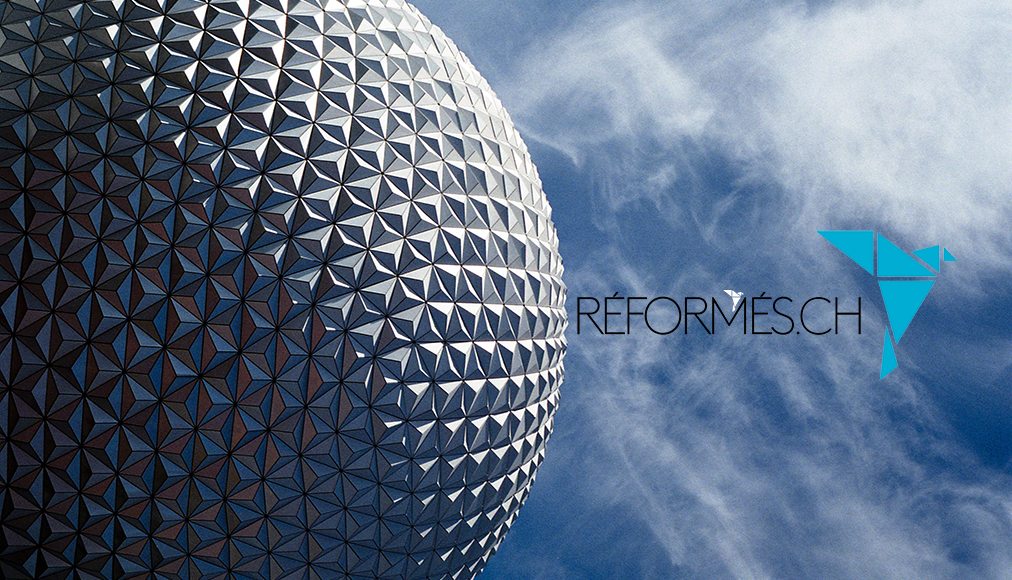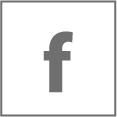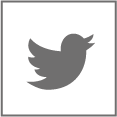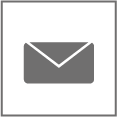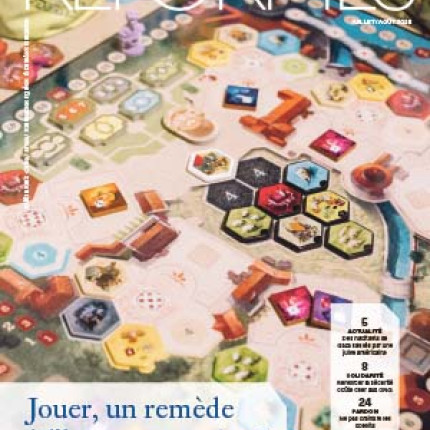L’Etat peut-il se passer de Dieu ?
A défaut de faire toujours bon ménage, Dieu et l’Etat sont de vieilles connaissances. Le récent débat autour du préambule de la Constitution européenne a montré la complexité de la thématique abordée mercredi soir à l’Université de Lausanne (UNIL) lors de la troisième séance du cours public « religion et société ».
Un Etat sans droit divinTrès attendu, le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger a ouvert les feux avec quelques traits d’humour : « Venir parler de l’amour de Dieu est plus agréable que d’évoquer le coût des tunnels ferroviaires », a notamment plaisanté notre ministre des transports et des communications. Le doyen de fonction du gouvernement helvétique ne l’a pas caché : « Notre Etat n’a pas besoin de Dieu. La Confédération n’est pas un Etat religieux ». Dans une démocratie moderne, les pouvoirs doivent être à la fois séparés et légitimés par le peuple souverain. « Une telle conception de l’Etat n’implique pas une profession de foi pour ou contre Dieu », a relevé le socialiste.
Reconnaissant pour autant « que les religions forment avec la philosophie des Lumières le socle de la société contemporaine occidentale », Moritz Leuenberger a ajouté qu’en définitive « Etat et religions se complètent. Le premier en garantissant la liberté religieuse, les secondes en façonnant nos sociétés à travers leurs principes moraux ».
Le Conseiller fédéral a enfin noté qu’aujourd’hui en Suisse, la discussion sur les liens qu’entretiennent cantons et religions se focalise sur deux aspects principaux : la nécessaire reconnaissance d’autres communautés, « un facteur de paix sociale ». Et, d’un autre côté, la question du mode de financement des institutions ecclésiales : doit-elle passer par une fonctionnarisation du clergé, comme dans le canton de Vaud, ou se régler via un impôt ecclésiastique facultatif ? La préférence de Moritz Leuenberger va plutôt vers la seconde solution, « la séparation avec l’Etat se justifiant dans la mesure où les Eglises ne représentent aucun pouvoir séculier ».
Le sociologue des religions Jörg Stolz, professeur à l’UNIL, a aboutit à une conclusion similaire : Dans une société suisse marquée par une poussée de l’athéisme, une sécularisation croissante et une pluralisation de la foi dues aux mouvements migratoires, l’Etat peut fort bien se passer d’une invocation à la transcendance. « D’autant que tout le monde ne croit plus en une même divinité ». Le directeur de l’Observatoire des religions en Suisse ne pense pas, contrairement au théologien allemand Hans Küng, que seules les religions peuvent apporter les valeurs et la cohésion sociale sans lesquelles l’Etat moderne n’existerait pas. « Oui, la religion transmet une éthique de base et contribue au lien social. Mais désormais, elle n’est pas seule à pouvoir le faire. Il est d’ailleurs légitime de se demander si les grands monothéismes soutiennent des valeurs communes ». En revanche, a conclu Jörg Stolz, « l’Etat doit s’intéresser au religieux », ne serait-ce que pour garantir la liberté de culte et veiller à l’existence d’une éducation sur les religions.
Troisième intervenant, le spécialiste de l’histoire juive Yakov Rabkin, de l’Université de Montréal, a apporté un regard très différent sur cette thématique, en rappelant que « le projet de la majorité des sionistes était de libérer les juifs de la Torah, ce qui explique que beaucoup de rabbins et traditionalistes juifs considèrent encore « cette conception moderne d’un nationalisme juif comme opposée aux concepts religieux de diaspora et de rédemption ». Pour ces derniers, non seulement l’Etat d’Israël n’a pas éradiqué l’antisémitisme, mais constitue en quelque sorte « une négation de l’identité juive et une menace pour sa survie ».