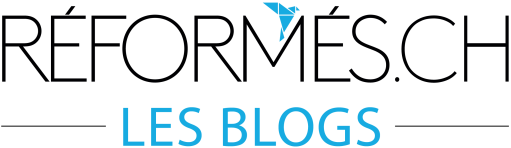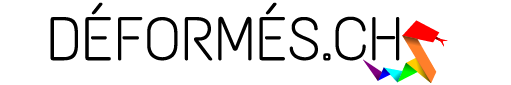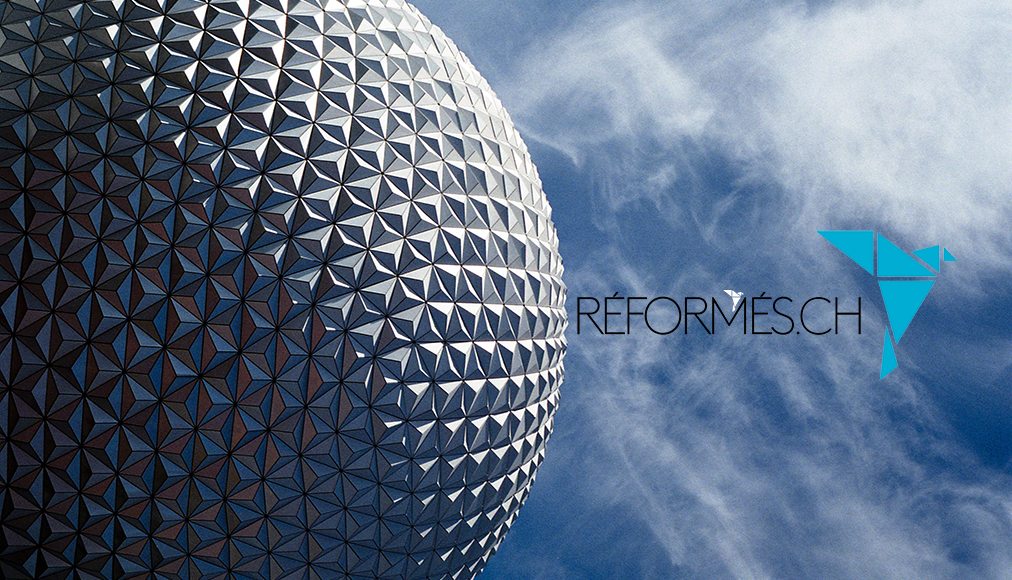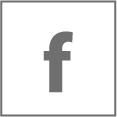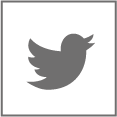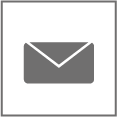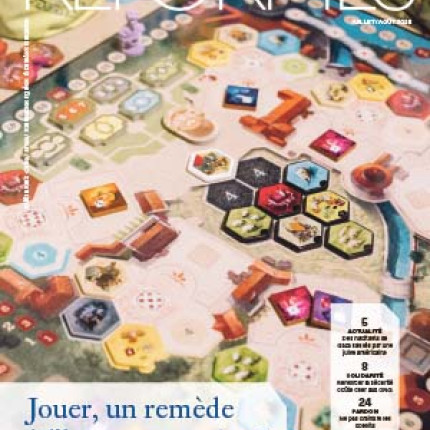Restaurer la confiance dans l'économie: un défi à long terme
31 juillet 2008
Dans le cadre des rencontres « Initiatives et changements » à Caux, des dirigeants d’entreprise venus du monde entier ont débattu de l’importance de restaurer la confiance dans l’économie et ses acteurs, pour améliorer la sécurité dans le monde
Parmi eux, Jean-Pierre Méan, conseiller juridique du groupe genevois SGS SA. Rencontre.Déclarer l’importance de la responsabilité sociale des entreprises et de l’éthique des acteurs économiques est fort bien et certains le font depuis des années. Mais cela sert-il concrètement à quelque chose ? La situation est loin d’être parfaite mais je constate ces dix dernières années une montée des considérations éthiques et morales dans de nombreuses entreprises et dans l’appréciation du monde économique face à certaines pratiques. Par exemple ? Dans les années 80 encore, si la corruption n’existait pas dans nos pays, personne ne s’offusquait d’y recourir pour travailler dans d’autres continents. On la tolérait comme un passage obligé pour faire des affaires. Aujourd’hui ce n’est plus accepté. De même ce que nous appelons un délit d’initié représentait un atout il y a 20 ans : un bon banquier était celui qui avait accès à des informations privilégiées pour en faire bénéficier ses clients. La pratique des entreprises est donc plus éthique qu’autrefois ?Dans certains domaines, c’est indéniable. En revanche, un nouveau contexte a exercé des effets pervers sur la vie des entreprises, avec des conséquences négatives. Je pense par exemple à la forte pression des actionnaires sur les résultats à court terme. Lorsqu’une direction a des objectifs à atteindre tous les trois mois, elle ne peut travailler dans la sérénité, ni mettre en place des stratégies à long terme. La situation en Bourse a-t-elle pris une importance prépondérante ? Tout-à-fait, pour plusieurs raisons : on gagne davantage en spéculant sur la finance pure qu’en produisant des biens ou des services. Les gens achètent des titres, non pas en espérant un dividende, même substantiel, mais pour augmenter leur capital en les revendant à moyen terme. Le cours de l’action est donc devenu un paramètre prépondérant de la vie entrepreneuriale, et il est influencé par des facteurs assez irrationnels. Lesquels ? L’important n’est pas de réussir à long terme mais d’avoir un résultat en hausse constante, si possible dépassant les prévisions des analystes. Et lorsque le cours baisse, il suffit d’agir pour que la valeur du titre augmente : changer le CEO ou licencier par exemple. Cela induit des comportements aussi difficiles à vivre dans l’entreprise, qu’indéfendables au plan de l’éthique. A cet égard, la crise financière actuelle est-elle salutaire ? Elle provoque des réajustements qui peuvent l’être. Si elle reconnecte certains traders avec la réalité, et si certains comprennent qu’on ne peut vivre éternellement à crédit, ce sera un pas en avant. Mais elle annonce aussi la fin des illusions et un appauvrissement des économies comme de la population. C’est une période difficile à traverser. Une transition similaire doit également avoir lieu si nous voulons mettre en place une mondialisation plus équilibrée.N’est-ce pas un vœu pieux ? Certains préfèreraient un retour en arrière. La mondialisation est un état de fait, créé par la mobilité et la communication. Je crois que ce mouvement est irréversible et positif, à condition de trouver des outils adéquats – et nous ne les avons pas encore – pour le gérer, afin qu’il profite à tous. Nous devons développer des institutions communes capables d’aller dans ce sens. Et accepter, dans les pays riches, de baisser notre niveau de vie. C’est difficile à admettre, mais inéluctable. Comment arriver à cet équilibre, alors que les partenaires ne partent pas avec les mêmes exigences en matière de niveau de vie, de droit social ou de protection de l’environnement ? Les dés ne sont-ils pas pipés ? Je vous accorde que c’est un vrai défi. Nous n’y parviendrons pas en quelques années. Je crois que nous pouvons nous accorder autour de certaines valeurs, celles des droits humains, quelles que soient nos croyances respectives. Monsieur Jamshed Irani, membre du Conseil de Tata Sons en Inde, a participé à nos discussions à Caux. J’y ai découvert que cette entreprise a été fondée par une famille zoroastrienne, très soucieuse du respect de ses employés. Les valeurs que nous voulons défendre sont très proches : les diffuser, par l’exemple d’abord, le dialogue aussi, est sans doute un de nos devoirs.