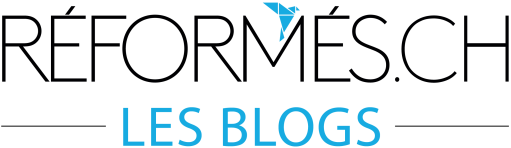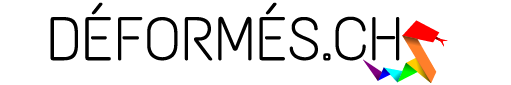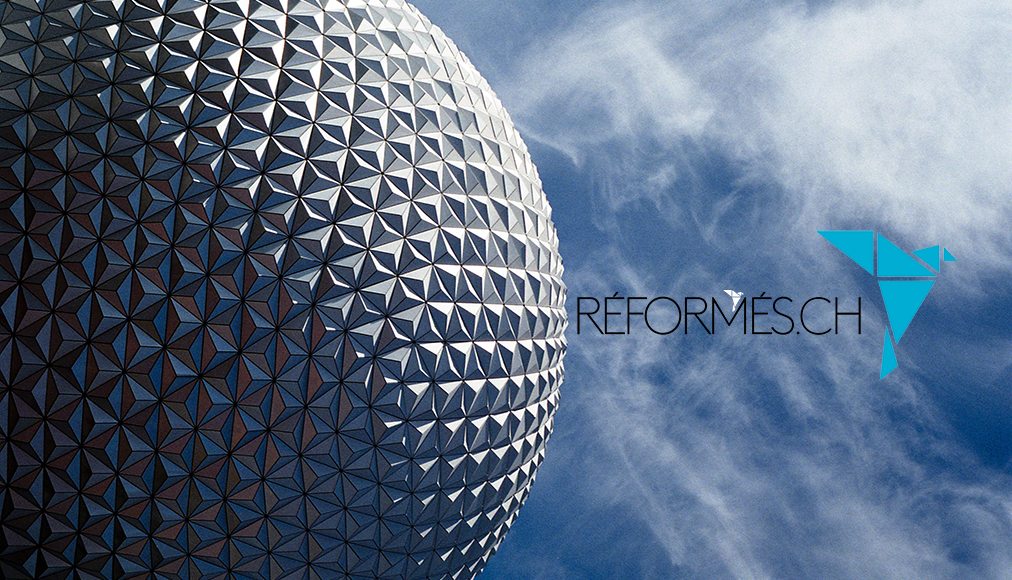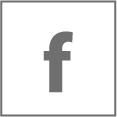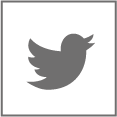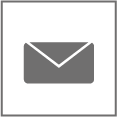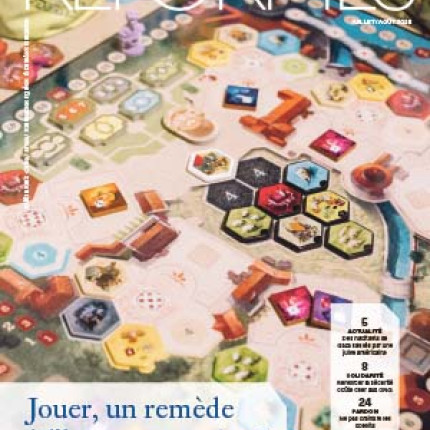La religiosité contemporaine au scalpel
20 janvier 2005
Beau succès, mercredi soir à Dorigny, pour la première soirée du cours public 2005 « Religion et société »
Le sociologue Roland Campiche et le psychothérapeute Patrice Guex ont livré leur compréhension de positions religieuses de plus en plus complexes.Démarrage remarqué mercredi soir à l’Université de Lausanne (UNIL), du cours public annuel consacré cette fois aux rapports entre religion et société. Devant un auditoire bien rempli, le sociologue Roland Campiche et le psychothérapeute Patrice Guex ouvraient les feux autour du titre évocateur « De Jésus à Bouddha, le religieux à la carte ? ».
Auteur d’une récente étude sur le sujet*, Roland Campiche a commencé par rappeler l’erreur consistant à considérer l’évolution de la religiosité en référence à la situation française, qui, loin d’être représentative, constitue au contraire l’exception. « Confessionnellement neutre, la Suisse n’est par exemple pas un pays laïque. A part dans deux cantons (Neuchâtel et Genève), il n’existe pas chez nous de stricte séparation entre les Eglises et l’Etat. C’est la situation qui prévaut d’ailleurs dans la plupart des nations européennes ». Une transcendance, mais sans institutionToutes les statistiques, dont celles issues de l’analyse du dernier recensement fédéral (lire notre article no 0808), le montrent : la référence à une transcendance, le besoin de prier ou la volonté de voir l’Etat encourager les connaissances religieuses, demeurent l’apanage d’une grande majorité de la population. La religion est donc bien présente dans notre société, mais ses expressions changent. « Ce sont les formes de régulation de cette religiosité moderne qui se sont multipliées : médias, école, famille, organisations diverses ont remplacé le dogme unique », explique Roland Campiche. Autonomie de l’individu, désinstitutionalisation avec perte d’influence des Eglises officielles au profit d’une appartenance religieuse plurielle, éloignement de la religiosité traditionnelle vers un autre type de croire fabriqué par chacun : tels sont les grands traits de l’expression spirituelle contemporaine. « Ce qui explique que les non-croyants et les croyants non chrétiens représentent désormais près de 45% de la population suisse », note encore le sociologue. Avec d’autres, Roland Campiche estime que les structures paroissiales traditionnelles sont inadaptées aux évolutions sociales, et notamment à la métropolisation galopante de la Suisse, traversée de « réseaux économiques et relationnels qui ignorent les anciennes frontières entre villes et campagnes ». Et le bouddhisme ?Autre point intéressant, l’influence du bouddhisme. Encore mal connue, elle semble bien réelle : alors qu’il existe à peine 25'000 bouddhistes dans notre pays, dont un cinquième seulement sont des Suisses convertis, 26% des Suisses affirment s’en sentir proches.
Responsable du Département de psychiatrie adulte du CHUV, Patrice Guex a emmené le public sur d’autres pistes. Frappé par « l’effacement d’une vision du monde structurée par la religion », le praticien évoque une « homme moderne unifié et maître de son destin, créant son monde et gérant son histoire ». Fêtes, transes, drogues, musique : les « rituels profanes » se multiplient pour « donner accès à un autre ordre de la réalité ».
Le mal existe. La maladie, la perspective de la mort constituent des moments charnières de la vie, des « possibilités nouvelles de notre être au monde » qui nous ramènent à la perspective de Job : pourquoi moi ? Y a-t-il quelqu’un qui me juge ? Est-ce que je fais le bien ? « Comment faire face au mal, celui que l’on commet et celui que l’on subit ? ». Bref, pour Patrice Guex, si la quête de sens, l’aspiration vers l’absolu demeurent universelles, « il existe des circonstances qui amènent à une sorte de disposition croyante ». Croyance que l’on se fabrique alors dans son coin, en plébiscitant le rôle social des Eglises, mais en leur refusant toute détention d’une vérité toute faite.UTILE
*Roland Campiche, « Les deux Visages de la religion » (Labor et Fides, 2004)
Le cours public « Religion et société » se poursuit le 26 janvier prochain (18 heures, collège propédeutique 2, auditoire E. Hamburger, 18h.) avec Isabelle Graesslé et Dounia Bouzar autour de « La femme émancipée tuera-t-elle la religion ? ». Parmi les 4 autres dates, on retiendra également la venue de Moritz Leuenberger avec "Dieu est-il nécessaire à l’Etat ? » (le 2 février), et de Tariq Ramadan le 23 février avec « Charia ou code pénal, quelle loi pour l’Europe dans 20 ans ? »
Auteur d’une récente étude sur le sujet*, Roland Campiche a commencé par rappeler l’erreur consistant à considérer l’évolution de la religiosité en référence à la situation française, qui, loin d’être représentative, constitue au contraire l’exception. « Confessionnellement neutre, la Suisse n’est par exemple pas un pays laïque. A part dans deux cantons (Neuchâtel et Genève), il n’existe pas chez nous de stricte séparation entre les Eglises et l’Etat. C’est la situation qui prévaut d’ailleurs dans la plupart des nations européennes ». Une transcendance, mais sans institutionToutes les statistiques, dont celles issues de l’analyse du dernier recensement fédéral (lire notre article no 0808), le montrent : la référence à une transcendance, le besoin de prier ou la volonté de voir l’Etat encourager les connaissances religieuses, demeurent l’apanage d’une grande majorité de la population. La religion est donc bien présente dans notre société, mais ses expressions changent. « Ce sont les formes de régulation de cette religiosité moderne qui se sont multipliées : médias, école, famille, organisations diverses ont remplacé le dogme unique », explique Roland Campiche. Autonomie de l’individu, désinstitutionalisation avec perte d’influence des Eglises officielles au profit d’une appartenance religieuse plurielle, éloignement de la religiosité traditionnelle vers un autre type de croire fabriqué par chacun : tels sont les grands traits de l’expression spirituelle contemporaine. « Ce qui explique que les non-croyants et les croyants non chrétiens représentent désormais près de 45% de la population suisse », note encore le sociologue. Avec d’autres, Roland Campiche estime que les structures paroissiales traditionnelles sont inadaptées aux évolutions sociales, et notamment à la métropolisation galopante de la Suisse, traversée de « réseaux économiques et relationnels qui ignorent les anciennes frontières entre villes et campagnes ». Et le bouddhisme ?Autre point intéressant, l’influence du bouddhisme. Encore mal connue, elle semble bien réelle : alors qu’il existe à peine 25'000 bouddhistes dans notre pays, dont un cinquième seulement sont des Suisses convertis, 26% des Suisses affirment s’en sentir proches.
Responsable du Département de psychiatrie adulte du CHUV, Patrice Guex a emmené le public sur d’autres pistes. Frappé par « l’effacement d’une vision du monde structurée par la religion », le praticien évoque une « homme moderne unifié et maître de son destin, créant son monde et gérant son histoire ». Fêtes, transes, drogues, musique : les « rituels profanes » se multiplient pour « donner accès à un autre ordre de la réalité ».
Le mal existe. La maladie, la perspective de la mort constituent des moments charnières de la vie, des « possibilités nouvelles de notre être au monde » qui nous ramènent à la perspective de Job : pourquoi moi ? Y a-t-il quelqu’un qui me juge ? Est-ce que je fais le bien ? « Comment faire face au mal, celui que l’on commet et celui que l’on subit ? ». Bref, pour Patrice Guex, si la quête de sens, l’aspiration vers l’absolu demeurent universelles, « il existe des circonstances qui amènent à une sorte de disposition croyante ». Croyance que l’on se fabrique alors dans son coin, en plébiscitant le rôle social des Eglises, mais en leur refusant toute détention d’une vérité toute faite.UTILE
*Roland Campiche, « Les deux Visages de la religion » (Labor et Fides, 2004)
Le cours public « Religion et société » se poursuit le 26 janvier prochain (18 heures, collège propédeutique 2, auditoire E. Hamburger, 18h.) avec Isabelle Graesslé et Dounia Bouzar autour de « La femme émancipée tuera-t-elle la religion ? ». Parmi les 4 autres dates, on retiendra également la venue de Moritz Leuenberger avec "Dieu est-il nécessaire à l’Etat ? » (le 2 février), et de Tariq Ramadan le 23 février avec « Charia ou code pénal, quelle loi pour l’Europe dans 20 ans ? »